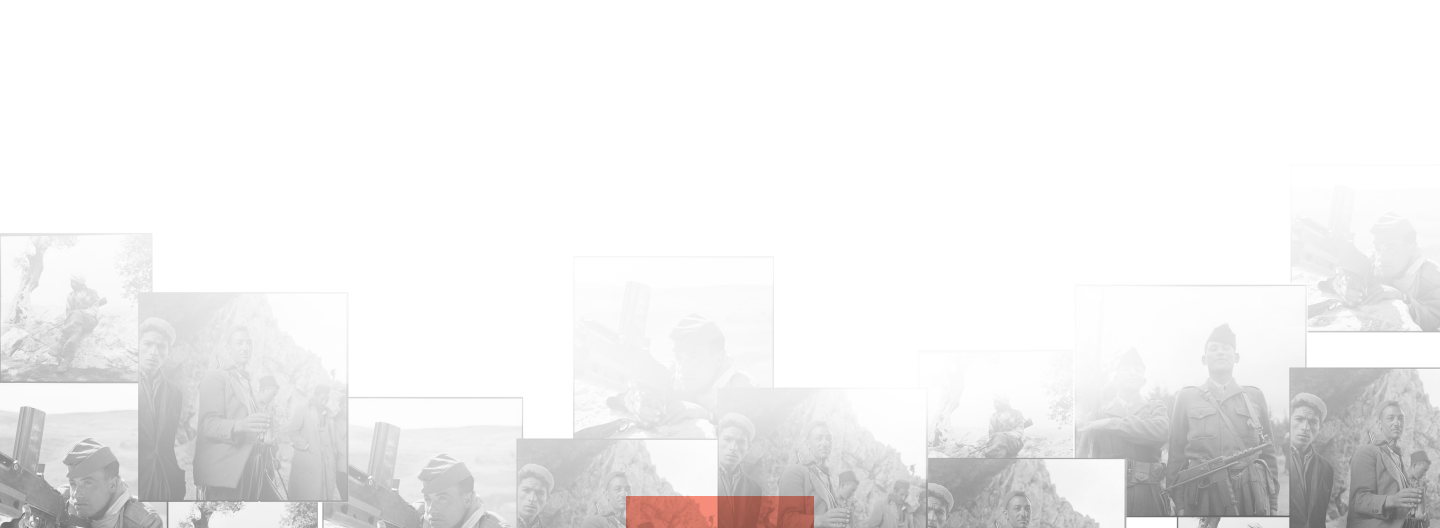Youtube - Les Harkis : un destin tragique
Crédits de fin :
Réalisation : Benjamin Brillaud
Recherches : Jean de Boisséson
Texte : Benjamin Brillaud, Jean de Boisséson
Iconographie : Bastien Verdier
Montage : Wilfried Kaiser “Dead Will”
Le destin tragique des harkis, combattants algériens que la France a abandonnés
Mes chers camarades, bien le bonjour ! Il y a des sujets qui sont plus simples que d’autres à aborder quand on fait des vidéos sur YouTube. Les morts insolites des rois, les jobs nuls, les inventions dues au hasard…C’est passionnant mais niveau terrain glissant, ça va, je ne me mouille pas trop. Aujourd’hui, je vous propose de faire l’inverse. On va parler d’un des sujets les plus difficiles que j’ai eu à aborder sur la chaîne, toute époque confondue. Tout simplement parce que c’est un sujet sensible au cœur même d’un autre sujet sensible : les harkis et la guerre d’Algérie. Qui étaient véritablement les Harkis ? Pourquoi se battaient-ils, et quel a été leur sort ?
On va faire un truc, tous ensemble, avant de commencer cet épisode si vous le voulez bien. On n’est pas sur une chaîne de Yoga mais… on va souffler un peu…
*souffle*
Allez, c’est parti !
Lors de la guerre d’Algérie, certains combattants d’origine algérienne étaient engagés dans les rangs français. Encore aujourd’hui, on a beaucoup de clichés qui circulent sur eux : ce seraient tous des “harkis”, ils auraient “choisi la France” par fidélité et par idéal national. Certains n’hésitent pas à les considérer comme des “traîtres”, des fuyards, ou des poids morts abandonnés. Ayant combattu sous les drapeaux, on pourrait croire qu’après le conflit, ils se sont tous réfugiés en France, où ils ont été bien accueillis et intégrés. Sauf que la véritable histoire de ces hommes, de leurs femmes, de leurs familles, est parfois très éloignée de toutes ces idées reçues et de toutes ces insultes !
C’est une histoire brûlante, pleine d’enjeux politiques et mémoriels très très actuels : on parle quand-même de 900.000 à 1 million de Harkis et de descendants de combattants qui sont concernés, et pourtant la CNIH, la Commission Nationale Indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis, ne date que de 2021 !
Pour mettre en avant cette histoire, cette commission nationale m’a contacté et j’ai accepté, parce que je pense que c’est hyper important de parler de tout ça.
À travers l’Histoire, bien des empires ont utilisé des troupes auxiliaires : par exemple, les Romains avaient des auxiliaires germains, gaulois, sarmates, et les empires coloniaux modernes avaient des “supplétifs”, c’est-à-dire des soldats autochtones qui complétaient leur armée régulière au cœur des territoires occupés.
Si on prend quelques exemples en Afrique, les Britanniques avaient les soldats askaris et les Espagnols comptaient sur les combattants rifains.
En Algérie justement, les supplétifs datent du début de la conquête française sous le règne de Charles X, et vont continuer de servir un bout de temps, pendant encore deux guerres mondiales, et jusqu’à notre actuelle 5e République !
Mais la décolonisation progresse partout dans le monde, et en octobre 1954 est créé le FLN, le Front de Libération Nationale, un mouvement indépendantiste algérien. L’insurrection éclate en novembre, via le bras armé du FLN : l’ALN, c’est-à-dire l’Armée de Libération Nationale.
Évidemment, ce conflit frappe particulièrement les Algériens engagés dans l'armée française. D'un côté, ils sont eux aussi Algériens, mais de l’autre, ils sont enrôlés dans les rangs français.
Dans ces conditions, l’armée pourrait les mettre à l’écart : sauf que non, ils présentent plein d’atouts précieux ! D’abord, ils répondent à un besoin essentiel : l’Algérie est sous-administrée, avec une policière trop faible. Les supplétifs peuvent renforcer les rangs du maintien de l’ordre.
Ensuite, ils ont une excellente connaissance du terrain, et ils parlent les langues, aussi bien arabe que berbère. Ils créent donc du lien avec la population, bénéficiant parfois d’appuis locaux.
Et enfin, les supplétifs apportent aussi, du point de vue de la France, de la légitimité politique : eh oui, dans cette « guerre d’indépendance algérienne », avoir des Algériens de son côté, c’est un peu prouver que les indépendantistes ne sont qu’une faction, qui ne représentent pas la totalité du peuple !
C’est d’ailleurs facile à croire sur le moment : l’ALN fonctionne par attentats, visant en priorité les musulmans alliés des Français. Puis il finit par frapper “à l’aveugle” des civils, dans le but de creuser la séparation entre les deux peuples.
Dans ce contexte de guerre ouverte, l’état-major français décide d’employer des supplétifs algériens dans un nouveau genre d’unités mobiles. En arabe, mobile, ou “mouvement” se dit harka. Ces soldats, ce seront donc les Harkis.
Depuis février 1956, les Harkas participent aux opérations de maintien de l’ordre, elles se mobilisent et se déplacent pour participer aux combats : de tout l’empire colonial, ce sont les seules troupes supplétives à avoir une vocation offensive ! Situé au plus près du danger, c’est elles qui connaissent le plus de pertes humaines tout au long du conflit, avec 1.800 hommes tués.
Donc à la base, Harki est un type bien spécifique de troupes mobiles. Mais le terme se généralise, et finit par désigner tous les supplétifs algériens. En réalité, sur 217.000 combattants algériens employés par la France, seuls 57.000 appartiennent aux Harkas. Plein d’autres unités de différents genres, à commencer par les 67.000 appelés du contingent, effectuent tous types de mission d’appui, de quadrillage du territoire ou de protection des populations rurales.
Parmi les unités supplétives il y a les SAS, les GMS et les GAD. Les SAS, ou Sections Administratives Spécialisées, sont simplement des structures qui gèrent la vie en Algérie rurale, construisent des infrastructures, administrent les villages, protègent, soignent et scolarisent la population. Mais elles comptent 19.450 auxiliaires, les Moghaznis, qui sont statiques et défensifs, et ne participent à des opérations militaires que dans leur secteur.
Les 9.100 hommes des GMS, ou Groupes Mobiles de Sécurité, sont des gardes ruraux, un peu l’équivalent de nos actuels gendarmes, qui assurent la surveillance des campagnes et la protection des biens et des personnes.
Enfin, il y a les 65.850 membres des GAD, ou Groupes d’Auto-Défense, qui ne font même pas partie de l’armée : ce sont simplement des bénévoles qui se chargent de protéger leurs villages et hameaux contre les attaques du FLN. Le gouvernement leur fournit des armes, mais ils n’ont pas de réelle organisation.
Tout ça fait quand-même un paquet de monde ! Du coup, on peut se demander : pourquoi autant ? Quelles sont les raisons de s’engager dans ce camp-là, et pas dans l’autre ?
Ici, on va essayer de faire attention aux idées reçues. C’est vrai que certains Harkis s’engagent par tradition familiale ou par attachement à la France. Mais c’est loin d’être la seule raison : tous n’ont pas “choisi” la France en suivant la même logique nationale.
En fait, l’engagement peut aussi répondre à des logiques familiales, locales ou encore économiques. Par exemple, beaucoup s’engagent ainsi moins pour la France que contre les violences commises par certains membres du FLN ou de l’ALN.
Ensuite, parfois après une première vague de violence, certains chefs de villages ou de clans poussent à un engagement collectif d’un côté ou de l’autre. Et enfin, la solde de l’armée suffit parfois à convaincre : c’est pour ça que le recrutement se fait principalement au sein de populations rurales pauvres. On s’engage pour l’argent.
Alors, entre nécessité, effet de groupe, besoin de protection, voire contrainte, ça balance pas mal d’un côté et de l’autre. Et il ne faut pas oublier les fois où c’est carrément obligatoire. En gros on oblige les gens à venir se battre pour la France : parfois, on menace même la recrue, en l’exposant à l’ALN ou en la torturant, pour qu’elle n’ait pas d’autre choix que de rentrer dans les rangs ! Et dans ce dernier cas, il y a un nombre important de personnes qui ne se présentent tout simplement pas ou qui désertent.
Pendant ce temps-là, la guerre continue et s'envenime salement. Si vous voulez en savoir plus sur le contexte, je vous invite vraiment à découvrir les épisodes qu’on a déjà fait. Il y en a trois sur l'Algérie, un sur la conquête de l'Algérie par la France, un autre sur l'Algérie française et un troisième sur la décolonisation et donc sur la guerre d'Algérie. Ce qu'il faut se dire en tout cas, c'est que sa mélange crise politique, chute de la 4e République, putsch militaire, création d'organisations terroristes et surtout de plus en plus de recours à des attentats violents qui tuent des militaires mais aussi des civils.
Pendant ce temps, la guerre continue, et s’envenime salement. Ce sera peut-être l’occasion d’un futur épisode, mais il faut se dire que ça mélange crise politique, chute de la 4e République, putsch militaire, création d’organisations terroristes, et surtout, de plus en plus de recours à des attentats violents, qui tuent des militaires mais aussi des civils !
Face à une situation de plus en plus intenable un cessez-le-feu est établi le 18 mars 1962, lors de la signature des accords d’Évian. Le 21 mars, les Harkis sont démobilisés. On semble en bonne voie vers la paix, mais attention ce n’est pas fini ! Il faudra encore attendre le 8 avril pour qu’un référendum français vote l’indépendance, et le 5 juillet pour qu’elle soit proclamée.
Entre-temps, l’accord de cessez-le-feu prévoit quand-même les choses, en appliquant notamment le principe de non-représailles, je cite : “les deux parties s’engagent à interdire tout recourt aux actes de violence collective et individuelle.” On interdit toute discrimination, que ce soit en raison des opinions émises ou des actes commis durant le conflit. Notamment, aucun Algérien ne peut être ni forcé, ni empêché de quitter le territoire.
Sauf que ça ne se passe pas du tout comme prévu, au contraire : là où les militaires baissent les armes, ce n’est pas le cas pour tout le monde ! Chez les partisans de l’Algérie française, il y a l’OAS, l’Organisation de l’Armée Secrète, qui veut faire capoter les négociations par la force. Dans le camp des indépendantistes, le FLN aussi redouble de violence, et a monté tout un réseau de l’autre côté de la Méditerranée, directement sur le sol français !
Et les supplétifs algériens, dans tout ça ? En effet, la démobilisation n’a pas prévu des conditions de reconversion suffisantes pour les seuls Harkis des harkas. Et lorsqu’on parle de transfert vers la France, c’est toujours de façon minimisée : on incite vraiment les anciens combattants à retourner à la vie civile en restant en Algérie.
Rester sur place, ça arrange bien la France, et ça semble même une plutôt bonne idée aux anciens auxiliaires, qui pensent souvent que les choses vont s’arranger pour eux.
Mais ce n’est pas forcément le cas : ceux qui ont combattu pour la France se retrouvent finalement coincés dans une situation très très dangereuse ! Pendant des mois, certains d’entre eux subissent le plus de représailles sanglantes.
Les forces indépendantistes s’en prennent à eux, mais aussi à leurs proches et à leurs familles : en comptant les personnes torturées ou écrouées, les historiens parlent de plusieurs dizaines de milliers d’exécutions et d’assassinats.
Ce drame dure longtemps, et la France tarde à réagir. Le premier ministre Michel Debré met en place une commission, qui conclut à la nécessité de rapatrier les Harkis et leurs familles, car la France n’a “pas le droit [de les] abandonner”. Tous les supplétifs menacés sont recensés, et le 15 mai 1962, 5.000 d’entre eux bénéficient de ce plan de rapatriement.
Mais comme on a vu, 5.000, ce n’est pas vraiment un chiffre qui colle à la réalité sur le terrain ! La majorité des supplétifs menacés restent en Algérie, mais dès juillet 1962, le ministre des Armées Pierre Messmer, signale que les camps militaires sur place sont saturés : impossible d’abriter davantage de monde. Ceux qui veulent survivre, doivent embarquer.
Problème, dans le même temps, le gouvernement français interdit fermement les transferts vers la France. Sous le manteau, des officiers et des fonctionnaires décident de rapatrier des supplétifs placés sous leur commandement, ainsi que leurs familles. Certains finissent même par embarquer pour la France…clandestinement, un comble pour des anciens combattants !
Là on parle vraiment d’abandon : pas de place dans les camps, pas de place en France, ceux qui ont défendu le pays sont complètement laissés à leur sort. Et ça dure pendant des mois, où les Harkis continuent de se faire tuer !
Ce n’est que le 19 septembre 1962 que le Premier ministre Georges Pompidou ordonne enfin le rapatriement des supplétifs en France. Encore aujourd’hui, c’est difficile de déterminer leur nombre exact. On estime qu’ils seront, au final, entre 80 et 90.000 à se réfugier sur le sol français. Mais une grande majorité, soit 66.000, l’a fait par ses propres moyens, entre juin et septembre 1962.
Mais les malheurs ne s’arrêtent pas là : car même une fois arrivés “en sécurité” sur le territoire, les conditions d’accueil ne sont pas faciles ! Pour loger autant de monde d’un coup, on a d’abord recours aux camps de transit et de reclassement. Il y en a six : le Larzac, Bias, La Rye, Rivesaltes, Saint-Maurice-L’Ardoise et Bourg-Lastic.
Ce sont tous d’anciens camps militaires réorganisés à la hâte : les logements de tentes et de baraquements y sont précaires, et les conditions sanitaires, très difficiles, avec des rats, des poux et des maladies qui prolifèrent. Il y a aussi plus ou moins de restriction de liberté, avec des barbelés, des couvre-feux, des chefs autoritaires, et des contrôles à l’entrée et à la sortie.
Cette dernière mesure se fait parfois à la demande des réfugiés eux-mêmes, car rappelez-vous : le FLN est infiltré sur le territoire français, donc même ici, les tentatives de vengeance existent !
Comble de malheur, l’hiver 62-63 est particulièrement rude, les installations provisoires sont difficiles à chauffer, la tuberculose et la mortalité infantile s’installent, comme à Saint-Maurice-L’Ardoise, dont le cimetière d’enfants offre un triste spectacle…
Bien sûr, on sait que ces camps sont une solution très temporaire : le but, c’est de “recaser” les gens en leur trouvant un logement et un emploi. Là encore, on fait ce qu’on peut, mais c’est pas Versailles !
La première solution, ce sont les hameaux de forestage : en gros, on regroupe les familles les plus nombreuses dans des villages abandonnés ou des régions dépeuplées : femmes et enfants peuvent avoir un toit sur la tête, tandis que les hommes sont d’office employés par l’Office National des Forêts, par exemple pour servir de garde forestier ou lutter contre les incendies.
Au total, 75 hameaux de forestage sont ainsi conçus, dont 35 rien qu’en région PACA, dans le sud de la France. Mais tous ont les mêmes défauts en commun : il s’agit de camper près des chantiers forestiers, donc dans des zones géographiquement isolées, parfois montagneuses. Les logements sont exigus, surchargés, précaires, parfois mal chauffés ou mal alimentés en eau.
Certes on gagne en liberté, mais attention au chef de chantier, ou à la monitrice de promotion sociale, qui peut vous aider…ou vous laisser coincés dans votre trou ! A la base, le hameau est censé précéder une vraie intégration au sein du pays, dans les villes par exemple… Sauf que souvent, cette solution pas très agréable perdure !
Deuxième solution mise en œuvre : les deux cités d’accueil de Bias et de Saint-Maurice-L’Ardoise. Elles sont destinées aux gens jugés “incasables”, donc aux Harkis inaptes au travail, par exemple à cause de blessures de guerre, d’infirmité, de maladie mentale ou d’âge. À noter que les mères seules sont aussi comptées dans cette catégorie.
Pour tous ces gens-là, c’est encore pire : avec peu de moyens de transport et une scolarisation interne, les cités isolent et favorisent l’entre-soi. Leur environnement est militaire et carcéral, avec des gardiens, des grillages et des visites contrôlées. Les libertés et les droits subissent bien des restrictions, comme le contrôle et l’ouverture du courrier, ou l’affectation des prestations sociales… aux dépenses du camp !
Et à nouveau, on parle de logements précaires, insalubres et surpeuplés, ou l’accès à l’hygiène est parfois restreint. A Bias, on sait que l’accès aux douches se fait une fois par semaine, et encore c’est payant : pas étonnant que les parasites prolifèrent ! Dans ces conditions, la santé mentale en pâtit aussi : l’alcoolisme, la violence, les maladies psychiatriques sont démultipliés.
Bref, j’arrête là, vous avez compris. Le principal problème, c’est que tout ça serait limite supportable pour une brève période même si c’est totalement indigne… Mais là ce n’est pas le cas, justement ! On se retrouve bloqué, et même, ça peut sauter une génération !
Par exemple, entre violence, isolement, ségrégation scolaire et racisme ambiant, 40% des enfants de Harkis ne sont pas diplômés. Un vrai handicap pour les décennies à venir !
Finalement, l’abandon de fait ne s’est pas vraiment arrêté en septembre 62 : au contraire, il s’est étendu jusqu’à susciter un fort sentiment d’abandon. Mais aussi d’humiliation, surtout chez les jeunes, isolés, non francophones, en quête d’identité, qui n’ont pas fait la guerre, et qui pourtant en subissent toutes les conséquences !
Alors, en 1975, c’est la révolte des camps de Bias et Saint-Maurice-L’Ardoise : les enfants de Harkis se soulèvent contre leurs conditions de vie. Si bien qu’au cours de l’année, la fermeture des camps est décrétée.
Ce coup de force a un autre effet : enfin, enfin les pouvoirs publics prennent conscience de la situation ! À partir de là, va s’engager un très long et très lent processus de reconnaissance et de réparation.
Au fil des décennies, les revendications se poursuivent, et les gouvernements successifs finissent par se prononcer : sous Chirac, l’engagement et les souffrances des Harkis sont reconnus. Sous Sarkozy et Hollande, on admet aussi la responsabilité de la France.
Avec ça, un certain nombre de dispositifs sont mis en place : selon l’urgence de la période, et en fonction de la situation de chacun, on envisage un peu tout. Par exemple, pour ceux qui ont tout quitté, on indemnise les spoliations et les pertes des biens et des terres.
On aide à rembourser les dettes des travailleurs indépendants, des allocations sont versées aux anciens combattants ou à leurs conjointes, veuves ou orphelins. On peut aussi aider à acheter, louer ou rénover un habitat. Des bourses sont octroyées pour les études et la formation, et des fonds de solidarité sont mis en place pour les descendants de Harkis. Peu à peu, les choses commencent donc à s’arranger.
2021 marque le tout dernier tournant en date : à l’occasion de la réception à la mémoire des Harkis, la France leur adresse une demande de pardon officielle. Le 23 février 2022, la loi de reconnaissance et de réparation pour les Harkis et leurs familles entérine toutes les reconnaissances précédentes.
Par la même occasion, on crée la CNIH, la Commission Nationale Indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis. Elle a deux volets. D’abord, la reconnaissance : il s’agit de transmettre la mémoire des Harkis et de leurs proches à l’aide de visites de terrain, de recueil des témoignages et des demandes des associations.
Le second volet, c’est la réparation : il faut statuer sur les demandes d’indemnisation : qui a séjourné dans quel camp ? Quelle famille de quel combattant a été placée dans telle ou telle structure d’accueil ?
Et là, vous l’avez compris : c’est un vrai boulot d’historien en fait ! Il faut faire une expertise historique sur place, enquêter, creuser les archives, récolter les dépositions… Ce n’est pas de tout repos ! Et en plus, tout ça a un pendant juridique aussi !
En effet, concernant les conditions de vie dans les camps, il s’agit aussi de trancher devant les tribunaux, si tel ou tel lieu n’a pas violé la Convention européenne des droits de l’Homme.
Et puis, si les conditions de vie sont particulièrement indignes dans les cités d’accueil, en particulier concernant les restrictions des libertés individuelles, peut-on en dire autant dans toutes les situations ? Entre simple “transit” ou maltraitance de longue durée, où placer la limite ?
Enfin, faut le dire : toute cette question mémorielle, politique, historique et juridique concerne beaucoup, beaucoup de monde. De nos jours, les supplétifs algériens et leurs descendants représentent entre 900.000 et 1 million de personnes ! C’est donc une histoire qu’on a trop longtemps mise sous le tapis !
Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ces débats sont encore loin d’être finis, et la CNIH doit traiter tous ces aspects qu’on vient d’aborder en même temps. Honnêtement ce n’est pas évident et je les remercie de m’avoir contacté pour cet épisode vraiment pas comme les autres parce que le sujet est délicat.
Après avoir travaillé sur le sujet, je pense que le cœur de leur mission peut se résumer en deux phrases : réparer l’injustice. Guérir les blessures. L’injustice, au singulier, parce qu’elle est commune, universelle, partagée par tous. Les blessures au pluriel : elles sont propres à chacun, elles sont tissées dans chaque histoire individuelle qui sont bien différentes les unes des autres. C’est un vrai travail d’équilibriste ! Alors merci à eux, merci à Jean de Boisséson pour la rédaction, et merci à vous, parce que vous portez ce souvenir, vous supportez la chaîne, parfois c’est dans les anecdotes très flamboyantes de l’Histoire, parfois c’est sur des pages plus sombres, plus difficiles à partager comme celle-ci.
Je tiens à remercier tout spécialement l’ECPAD, l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense, qui nous a fourni des images d’archives pour cet épisode sur la guerre d’Algérie.
L’ECPAD conserve des fonds exceptionnels sur tous les conflits dans lesquels l’armée française a été engagée depuis 1915. Ça fait quand même 15 millions de photos et 100.000 heures de films, conservées au Fort d’Ivry-sur-Seine !
Le but étant de rendre accessible ces archives, vous pouvez retrouver une partie de ces images directement sur le site ecpad.fr. C’est plein de ressources passionnantes et si vous y faites un tour via le lien en description, c’est aussi une façon de leur dire merci !
A très bientôt !
—------------------------------------
BIBLIOGRAPHIE :
Abderahmen Moumen, “Les harkis, de l’Algérie à la France”, in Chemins de Mémoire, site du Ministère des Armées.
François-Xavier Hautreux, “La guerre d’Algérie des harkis”, in Chemins de Mémoire, site du Ministère des Armées.
Raphaëlle Branche (dir.), La guerre d'indépendance des Algériens - 1954-1962, Perrin, coll. « Tempus », Paris, 2009, 356 p.
Stéphanie Chauvin, “Des appelés pas comme les autres ? Les conscrits « français de souche nord-africaine » pendant la guerre d'Algérie”, in Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°48, octobre-décembre 1995. pp. 21-30.
Rapport annuel d’activité de la CNIH 2022 et 2023-2025.
Rubriques “Les Harkis : qui sont-ils ?”, et “Paroles de Harkis”, in harkis.gouv.fr
Focus “Les Accords d’Évian, l’Algérie sur la voie de la paix”, in imagesdefense.gouv.fr